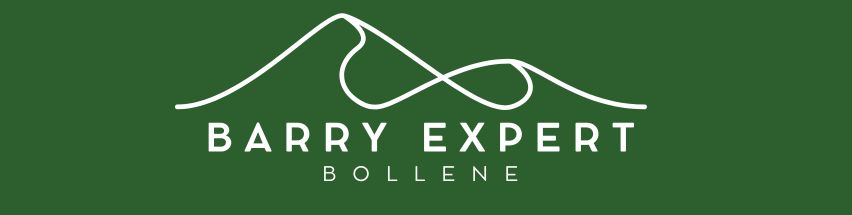Histoire de l'exploitation des carrières du Massif du Barry
Table des matières
1. Les origines de l’exploitation : Antiquité et Moyen Âge
Le Massif du Barry, situé à cheval sur les communes de Bollène, Saint-Restitut et Saint-Paul-Trois-Châteaux, possède une longue et riche histoire d’exploitation de ses carrières. Cet héritage témoigne non seulement de l’évolution des techniques d’extraction de la pierre, mais également de l’importance économique et sociale qu’a représenté cette activité à travers les siècles. Ce document se propose de retracer cette histoire depuis l’Antiquité jusqu’aux initiatives modernes de préservation.
1.1. Premières exploitations à ciel ouvert
Des traces de l’exploitation des carrières du Massif du Barry remontent à l’époque romaine.
- Méthodes traditionnelles :
Les premiers carriers utilisaient des techniques simples, empruntées à des méthodes anciennes, pour extraire la pierre. Par exemple, ils pratiquaient des incisions horizontales avec des outils en pierre ou en bronze et inséraient des coins en bois dans des trous pratiqués à l’aide de burins. - Usage et débouchés :
La pierre extraite était utilisée localement pour la construction d’infrastructures, mais elle était aussi expédiée vers des centres urbains majeurs du sud-est de la Gaule, comme Orange (où l’on utilisera la pierre dans des édifices publics) et même dans la région lyonnaise (théâtres et édifices municipaux).
Source :
- Dercourt, J. (2000). Géologie de la Provence. CNRS éditions.
- Revue Archéologique de Provence (articles sur l’exploitation romaine des carrières).
1.2. Exploitation médiévale
Au Moyen Âge, les carrières continuent de jouer un rôle crucial dans l’architecture régionale.
- Utilisation locale :
La pierre était employée pour bâtir des édifices religieux, des fortifications et des châteaux, dont certains vestiges subsistent encore aujourd’hui (par exemple, les ruines des châteaux de Chabrières et de Barry). - Organisation du travail :
Bien que les techniques n’aient pas évolué de manière spectaculaire par rapport à l’Antiquité, le travail des carriers se professionnalise progressivement, posant les bases des méthodes d’extraction futures.
Source :
- Favre, L. (2009). Carrières et patrimoine de la Provence. Avignon : Editions Alpina.
- Archives régionales et documents médiévaux recensant l’utilisation de la pierre.
2. L’essor industriel et la révolution technique (XVIIe – XIXe siècles)
2.1. L’amélioration des techniques d’extraction
Le passage du travail artisanal aux techniques plus mécanisées marque une période de transition importante :
- À ciel ouvert et technique du burinage :
Jusqu’au XVIIIe siècle, l’extraction se fait principalement à ciel ouvert. Les carriers procèdent en effectuant des trous de burin, dans lesquels sont introduits des coins en bois. L’arrosage de ces coins provoque leur gonflement et la fragmentation de la roche. Cette méthode, héritée des techniques égyptiennes et romaines, reste efficace pour découper les blocs de pierre. - Introduction de la « scie crocodile » :
Vers la fin du XVIIIe siècle, l’adoption de la scie dite « crocodile » permet de découper les blocs avec plus de précision. Ce nouvel outil réduit le risque d’éclatement intempestif de la pierre et permet un débit plus rapide de production.
Source :
- Robin, P. & Veyret, C. (2003). Stratigraphie et environnements sédimentaires du bassin méditerranéen. Éditions TECHNIP.
- Documents d’archives sur l’évolution des techniques de taille de pierre dans le sud de la France.
2.2. L’essor de l’exploitation souterraine
Avec l’augmentation de la demande en pierre, l’exploitation des carrières du Massif du Barry connaît une diversification des techniques d’extraction :
- Galeries horizontales et puits d’extraction :
Les carriers creusent des galeries souterraines à partir du niveau du sol ou via des puits d’extraction. Ces galeries permettent d’atteindre des couches de pierre de meilleure qualité tout en limitant l’impact visuel en surface. - Installation de systèmes mécaniques :
Des treuils et des plans inclinés sont mis en place pour faciliter l’acheminement des blocs extraits. L’un des projets les plus remarquables fut celui initié par le Baron du Bord à partir de 1845, qui, après avoir acquis une partie des carrières, construisit un plan incliné moderne permettant de transporter les blocs sur une pente de 20 cm par mètre sur une longueur de 850 mètres. Ce système, remplacé plus tard par des locomotives à vapeur, révolutionnera le transport de la pierre vers les gares et zones de stockage.
Source :
- Baudin, T. (2005). Tectonique et sédimentation en Provence. Éditions du CNRS.
- Archives techniques des carrières de Provence et rapports historiques des infrastructures industrielles régionales.
3. Le pic de l’exploitation (XIXe – début du XXe siècle)
3.1. Une activité économique florissante
La période comprise entre 1860 et 1914 représente l’apogée de l’exploitation des carrières du Massif du Barry.
- Volume de production et main-d’œuvre :
À cette époque, jusqu’à 400 personnes sont employées sur le plateau. Les carriers, spécialistes de la découpe de blocs pouvant atteindre 3 m³ (environ 6 tonnes), sont très bien rémunérés en raison de la technicité de leur travail et de la pénibilité des conditions de travail. - Utilisation dans des projets majeurs :
La pierre extraite est non seulement utilisée dans des constructions locales, mais aussi exportée dans tout le sud-est de la France (Marseille, Lyon, Grenoble, Vienne) et même à l’étranger (Genève, Lausanne, tunnel du Saint-Gothard, ainsi que des projets aux États-Unis). L’importance de cette activité est illustrée par la commande de la carrière Hugues pour les abattoirs de Lyon en 1914, marquant ainsi l’un des derniers grands chantiers de l’époque.
Source :
- Archives régionales du Vaucluse.
- Favre, L. (2009). Carrières et patrimoine de la Provence. Editions Alpina.
3.2. Les innovations en transport
Le transport de la pierre joue un rôle déterminant dans la compétitivité des carrières :
- Du plan incliné aux locomotives :
Le plan incliné mis en place par le Baron du Bord permettait initialement le transport des wagonnets sur rail en cinq minutes vers la gare inférieure. Cette infrastructure fut modernisée en 1865 avec l’introduction d’une locomotive à vapeur, remplaçant ainsi la traction animale et réduisant le temps de transit pour l’acheminement des blocs vers la gare de Pierrelatte. - Réseau logistique :
L’ensemble du système logistique comprend également des ponts, tranchées et vestiges de bâtiments servant à l’hébergement des chevaux, au contrôle de l’exploitation et à la maintenance du matériel roulant.
Source :
- Documents d’archives historiques sur les infrastructures ferroviaires et industrielles de la région.
- Études régionales sur la transformation du transport dans le sud-est de la France (disponibles dans les bibliothèques universitaires).
4. Les conditions de travail et l’impact social
4.1. Un métier de carriers : entre prestige et pénibilité
Le travail dans les carrières était à la fois valorisant et extrêmement exigeant.
- Compétences et rémunération :
Les carriers bénéficiaient d’une rémunération supérieure à celle des travailleurs agricoles, en raison de la technicité du métier et de la capacité à extraire et tailler la pierre de manière précise. - Risques et conditions de travail :
Les conditions de travail étaient difficiles : exposition à la poussière de pierre (risques de maladies pulmonaires), chaleur intense accentuée par la réverbération de la pierre blanche et risques d’accidents lors de l’extraction et du transport des blocs. - Sociétés de secours mutuels :
Pour pallier ces difficultés, les carriers créent des sociétés de secours mutuels, destinées à venir en aide aux familles en cas d’accident, de maladie ou de grève, témoignant d’un fort esprit communautaire et de solidarité au sein de la profession.
Source :
- Études sociologiques et archives professionnelles de la région.
- Publications régionales sur le patrimoine industriel, par exemple dans la revue Carrières & Patrimoine.
5. Le déclin de l’exploitation et les enjeux contemporains
5.1. La fin d’une ère
Après 1914, l’exploitation des carrières entame un déclin marqué par plusieurs facteurs :
- Première Guerre mondiale :
La mobilisation massive et le manque de main-d’œuvre contribuent à réduire considérablement l’activité des carrières. - Évolution des matériaux de construction :
L’avènement du béton armé et d’autres matériaux modernes entraîne une baisse de la demande en pierre traditionnelle. - Changements économiques :
La concurrence d’autres sources de matériaux de construction et la modernisation des techniques ont modifié le paysage industriel de la région.
Source :
- Favre, L. (2009). Carrières et patrimoine de la Provence.
- Archives historiques sur l’évolution de l’industrie de la pierre en France.
5.2. Préservation et valorisation du patrimoine
Depuis le printemps 2019, une nouvelle dynamique se met en place pour préserver ce patrimoine exceptionnel :
- Acquisition municipale :
Les communes de Saint-Paul-Trois-Châteaux et Saint-Restitut ont acquis la majorité des carrières auprès du groupe FIGUIERE, dans le but de sécuriser le site et de le valoriser. - Initiatives de valorisation :
Des projets de mise en valeur, tels que la création d’associations dédiées à la préservation, l’organisation de visites guidées (dans des zones sécurisées comme les « caves cathédrales » ou d’anciens théâtres d’images aménagés dans la pierre), et des parcours éducatifs, permettent de redonner vie à ces lieux chargés d’histoire. - Recherche scientifique et partenariats :
Des collaborations entre les universités, les institutions géologiques et les collectivités locales favorisent la recherche sur l’histoire industrielle et la géologie du massif, contribuant ainsi à une meilleure compréhension de cet héritage.
Source :
- Communiqués municipaux de Saint-Paul-Trois-Châteaux et Saint-Restitut.
- Initiatives du Géoparc de Provence et projets régionaux sur la valorisation du patrimoine industriel.
L’histoire de l’exploitation des carrières du Massif du Barry est un témoignage fascinant de l’évolution des techniques d’extraction, du rôle central de la pierre dans le développement économique régional et des conditions de travail parfois difficiles mais porteurs d’un fort esprit de solidarité.
De l’Antiquité à l’ère industrielle, en passant par le pic de l’activité au XIXe siècle, ce patrimoine industriel enrichit la culture locale et offre aujourd’hui des perspectives uniques en matière de préservation, de valorisation touristique et de recherche scientifique.
Sources complémentaires
- Dercourt, J. (2000). Géologie de la Provence. CNRS éditions.
- Favre, L. (2009). Carrières et patrimoine de la Provence. Editions Alpina.
- Robin, P. & Veyret, C. (2003). Stratigraphie et environnements sédimentaires du bassin méditerranéen. Éditions TECHNIP.
- Baudin, T. (2005). Tectonique et sédimentation en Provence. Éditions du CNRS.
- Revue Archéologique de Provence et Carrières & Patrimoine, articles et archives régionales.
- Archives du Vaucluse et documents des sociétés d’extraction locales.
- Communiqués et rapports des communes de Saint-Paul-Trois-Châteaux et Saint-Restitut ainsi que les initiatives du Géoparc de Provence.
Pages
Liens importants
Barry Expert Inspiré par BARRY-AERIA par CNDSEO
Copyright © 2025. Tous droits réservés